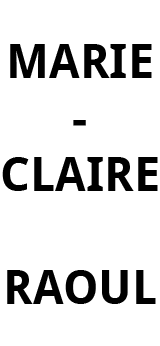De la nature
Continuons notre parcours jusqu’à la prairie de Keravilin. Installons-nous en face de ces deux images numériques accrochées au mur. Une simulation 3D et un tracé rouge : projections dans un espace, l’artificialité des images renvoie à celle des sols. Les espaces dits naturels sont en fait transformés, l’ensemble des vivants transforme son environnement constamment, de différentes manières…
Dour Gwenn nous entraîne dans ses courants enfouis. Plongeons avec elle dans le passé !
Dour Gwenn est le mot breton pour désigner l’eau blanche, ancien nom de la rivière qui traverse le vallon du Stang-Alar reliant les communes de Brest et de Guipavas. Cette rivière formait un étang au niveau de la prairie de Palaren et se jetait dans la mer par ce qui est maintenant la plage du Moulin Blanc. Cette zone humide a disparu. Elle existe encore dans l’histoire de la région et dans nos souvenirs. Elle existe aussi dans la mémoire de ces lieux qui portent encore dans leurs strates des traces de ces eaux.
Par cette installation végétale qui reprend la forme de l’étang oublié, Marie-Claire Raoul nous révèle ce qui se trouvait sous nos pieds et donne la parole à Dour Gwenn. Elle nous prie de regarder ce qui n’est pas visible, d’aller plus profond, couche après couche. De disparaitre dans les sols à l’image des saules plantés. D’imaginer les multitudes de paysages recouverts, de célébrer les métamorphoses du vivant et de renouer avec elles.
Elle nous met au défi de marcher sur l’eau blanche.
Badïa larouci, in « Livret des voyageureuses », édité par Espace d’apparence à l’occasion de l’exposition De la nature — Brest, mars 2022.